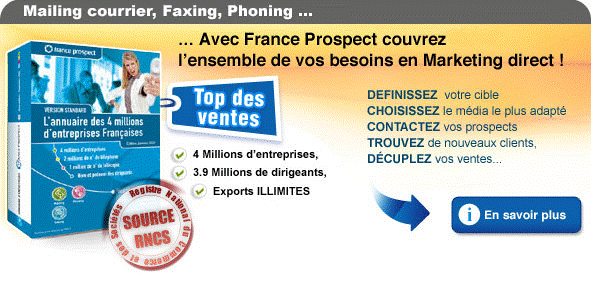
Les Atouts de la France en Logistique
CD ROM Annuaire d'Entreprises France prospect (avec ou sans emails) : REMISE DE 10 % Avec le code réduction AUDEN872
|
10% de réduction sur vos envois d'emailing --> CLIQUEZ ICI Les Atouts de la France en Logistique > > Conception rétro-logistique Héritière d’une vieille tradition commerciale, la France allie une position géographique privilégiée à l’expérience acquise en logistique, au fil des ans, par de nombreuses sociétés. Forte de ce passé conforté au présent, l’industrie logistique française est résolument tournée vers l’avenir pour assurer le développement des sociétés qui font le choix de la France. I. Du concept de logistique à la c h a î ne logistique globale (SCM) “Logistique”, “logistique intégrée”, “logistique globale”, “entreprise étendue”, “supply chain management (SCM)”, “chaîne clients-fournisseurs”, “global fulfillment”… autant d’appellations pour une discipline complexe qui emploie plus de 887 000 personnes en France et 6,5 millions dans l’Union Européenne. Si la logistique moderne a des origines militaires, elle est devenue à la fin du XX è m e siècle une fonction à part entière et, le plus souvent, stratégique dans la gestion des entreprises. Signe de son importance, la logistique concerne 8% à 12% du chiff re d’aff a i re s des entreprises françaises (120 milliards d’_) et 8% du PIB européen (soit 800 milliards _) . Fabrication Logistique interne (PGI, ERP) Livraison Logistique aval (DRP) Approvisionnement Logistique amont (SRM)Client Logistique extrême aval (ECR,CRM) La France, une immense plate-forme logistique Véritable façade atlantique du continent européen, carrefour entre l’Europe du Nord et le bassin méditerranéen, la France a naturellement vocation à occuper une place majeure dans la logistique mondiale. Les réseaux de communications terre s t res, aériens, fluviaux ou maritimes sont organisés autour de cette préoccupation. Les p rojets d’extension de la zone fret de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le développement des liaisons TGV ou le programme autoroutier sont quelques exemples de la volonté de la France d’accompagner l’évolution des besoins en terme de transport. L’importance du commerce international en France off re l’assurance de toujours t rouver un partenaire ou un pre s t a t a i re logistique pour développer son activité. Ce vivier de compétences se re t rouve également avec l’off re de formation dans le secteur. Que ce soit en formation initiale ou en formation continue, la France forme chaque année des milliers de spécialistes de la logistique, du cariste au logisticien en passant par l’informaticien de réseau. Faire de la France le cœur de sa logistique, c’est en fin de compte choisir un pays au cœur de la logistique. Des évolutions récentes Cette montée en puissance, significative au cours des 30 dernières années, a nourri une importante littérature. Parmi les principales raisons avancées pour expliquer le développement de la fonction logistique, la mondialisation des échanges entre les trois pôles (Alena, Espace Economique Européen, pays de l’Asean) occupe une place majeure. En dispersant les fournisseurs et clients aux quatre coins du monde, elle exige une maîtrise coordonnée des flux physiques et des flux d’information. La diversité croissante des produits et le raccourcissement de leur cycle de vie rendent plus complexe l’organisation de l’entreprise qui doit être souple et réactive pour f a i re face à l’obsolescence rapide des stocks et aux variations importantes de la demande. La contrainte temporelle est également forte en raison de la sure n c h è re permanente des attentes du client qui exige des produits personnalisés avec des délais de livraison toujours plus courts. Les entreprises doivent donc r a c c o u rcir leurs schémas de planification, de production et de livraison. Plus récemment les progrès exponentiels dans la maîtrise des flux d’informations grâce à l’EDI et à Internet permettent aux diff é rents acteurs de la chaîne logistique (fournisseurs, producteurs, distributeurs, pre s t a t a i res logistiques, clients), de communiquer en temps réel et d’optimiser chaque étape du p rocessus. La logistique devient ainsi de plus en plus transversale, globale, étendue, collaborative, à l’écoute du client. Elle permet, de ce fait, par son approche intégrée, de suivre un pro d u i t depuis sa conception jusqu’à son retrait (logistique d’extrême amont et rétro-logistique, Soutien Logistique Intégré ou SLI), de piloter des flux physiques et d’informations entre fournisseurs et producteurs (logistique amont), de fluidifier la production (logistique interne) et d’optimiser les flux entre fournisseurs et distributeurs (B2B)/client final (B2C) (logistique aval). Les progrès des outils et techniques de la logistique ne suffisent pas à assure r l ’ e fficacité d’une chaîne logistique. Celle-ci passe aussi par une organisation rationnelle de l’espace et du temps. C’est cette combinaison d’atouts que de nombreuses sociétés internationales sont venues chercher en France. “La fonction logistique fait appel à plusieurs métiers et savoir-faire qui concourent à la gestion et à la maîtrise des flux physiques et d’informations ainsi que des moyens”. Définition de la norme Afnor X50-600 I . Du concept de logistique à la chaîne logistique globale ( S C M ) I I . Logistique aval de distribution et atouts de la France I I . 1 Le territoire français, point d'entrée multimodal privilégié pour l’Union Euro p é e n n e I I . 2 Des plates-formes de plus en plus “intelligentes” I I . 3 Les gestionnaires des plates-formes : 3 PL, 4PL, LLP I I . 4 L’ industrie française de la manutention I I . 5 Développeurs de solutions informatiques pour la gestion globale de la chaîne logistique ( S C M ) I I I. Logistique d’extrême amont et rétro-logistique I I I I. E-logistics ou i n f o g i s t i c s I I I I I . Logistique collaborative G l o s s a i r e P. 4 P. 2 P. 18 P. 20 P. 22 P. 23II. Logistique aval de distribution et atouts de la France Une position centrale au cœur de l’Europe A l’échelle européenne, le choix de l’implantation d’un centre logistique doit permettre d ’ ê t re rapidement en contact avec le plus de clients possibles. De nombre u s e s e n t reprises étrangères qui souhaitent apporter à leurs clients européens un taux de service et de réactivité optimal ont choisi la France comme plate-forme logistique e u ropéenne. Sa position centrale au cœur d'un marché de 380 millions d'habitants et de 916 milliards de dollars de PNB en 2000, dépassant celui des USA et re p r é s e n t a n t le double de celui du Japon, est un atout indéniable. Un récent rapport du cabinet d’audit McKinsey citait la France comme étant le pays d ’ E u rope présentant le meilleur rapport qualité/prix pour y faire développer des activités commerciales. Du commerce à la logistique le pas est vite franchi et des études concordantes démontrent que les coûts logistiques y sont très concurre n t i e l s par rapport à la moyenne européenne. En France, le prix des transports reste modéré. Takao A m a s e, Président de Bridgestone/Firestone Europe >>> “Grâce à sa situation géographique, aux connexions à un réseau autoroutier bien développé et au réseau TGV avec accès au tunnel, la France est située de façon idéale pour satisfaire le niveau de service requis par notre clientèle. Ces facteurs et la qualité de la main d’œuvre ont constitué d’importants critères dans notre décision de doubler notre infrastructure d’entreposage en Fr a n c e. ” Parce qu’elle est directement liée à la politique commerciale de l’entreprise, la logistique aval est le centre de toutes les attentions. La taille du marché intérieur français et son ouverture sur l’Espace Economique Européen ou le bassin méditerranéen se cumulent à d’autres avantages concurrentiels pour faire de la France un centre logistique de choix. Premier maillon de la chaîne logistique, la logistique aval se situe entre le producteur et le distributeur. Elle devient d’extrême aval lorsqu’elle concerne les flux entre le distributeur et le client final. Le commerce électronique ouvre même la voie à une logistique des flux entre le producteur et le client final. Compétitivité et fiabilité La main d’œuvre qualifiée présente un coût horaire inférieur de 15 à 40% à celui des pays du nord de l’Europe. En terme de productivité, la main d’œuvre française se classe deuxième en 2002, selon le World Competitiveness Yearbook devant l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et la Grande Bretagne. Le prix des terrains demeure attractif et les coûts d’établissement et de construction sont bas. La France dispose d ’ i n f r a s t r u c t u res technologiques hors pair. Elle est le seul pays d’Europe qui off re un réseau de télécommunications 100% numérique. L’Internet haut débit ainsi que l’EDI (Echange de données informatisé) sont très répandus. Plus de 110 000 entre p r i s e s y ont recours. Enfin, les équipements collectifs sont appréciés par les investisseurs é t r a n g e r s . M. Dosch, PDG de Borg Warner A u t o m o t i v e, S. U.M (Tulle – Corrèze) >>> “Le groupe américain a apprécié la qualité de la main d’œuvre et les coûts horaires notamment plus compétitifs qu’en A l l e m a g n e ” Philippe Monneret, Directeur du site Ikea de l’Isle d’Abeau >>> “Nous cherchions un endroit stratégique en Europe du S u d , qui nous permette de réceptionner de la marchandise de fournisseurs en provenance d’Angleterre, des Pays Bas, de Fr a n c e, d ’ E s p a g n e, du Portugal, de Suisse. Les analyses de coûts de transport nous ont amenés à sélectionner Lyon comme étant l’endroit central idéal, a i n s i que le plus économique. ”Par voie maritime Sur l’Atlantique et la Manche, avec les ports de : • Le Havre, 1 e r port français pour la conteneurisation avec 60 % du trafic. Son extension “Port 2000 ” permettra l’accueil des navires les plus gro s , quels que soient la marée et le tirant d’eau. • R o u e n, très proche de Paris, est spécialisé dans les marchandises en vrac : bois, céréales, engrais. • D u n k e r q u e, en forte croissance avec 150 000 conteneurs EVP en 2001, le plus ferro v i a i re des ports européens avec 49 % du fret en transit empruntant la voie ferrée, contre 40% pour la route et 11 % pour la voie d’eau. • Par l’Arc atlantique, avec de nombreux ports spécialisés dans le vrac comme Bordeaux, La Rochelle, Nantes Saint-Nazaire, Lorient, B rest, Cherbourg et au nord Dieppe. En Méditerranée, avec le port de : • M a r s e i l l e - Fo s, le plus important de Méditerranée, est relié avec l'hinterland nord européen par un réseau dense d’autoroutes et de voies ferrées, mais également par l’ensemble fluvial Rhône-Saône. Le Port Autonome de Marseille (PAM), certifié ISO 9002 par le Lloyd’s de Londre s , développe depuis 1998 un programme pour accueillir à terme des navires de 8 000 TEU/EVP et atteindre 1 million d’EVP. Pour acheminer leurs marchandises vers ou depuis ces ports, les entreprises peuvent s’appuyer, par ailleurs, sur de grands armateurs maritimes comme la CMA-CMG (Compagnie Maritime d’Affrètement et Compagnie Générale Maritime), Delmas, leader mondial dans les liaisons Nord/Sud, Carg o s u d . Quel que soit le mode de transport choisi pour atteindre l’Union Européenne, la France offre des points d’entrée d’un excellent niveau technique et d’une grande efficacité dans le traitement des flux import ou export. Par voie aérienne Classés au troisième rang européen, les aéroports de Paris CDG / Orly totalisent 20% du fret aérien global de l’Union Européenne. 600 entreprises employant plus de 55 000 personnes dont 12 000 en logistique, s’y sont établies en raison de leur positionnement au cœur du bassin parisien, la région d’Europe au PIB le plus élevé. L’ i n t é g r a t e u r américain FedEx a construit sur l’aéroport CDG sa plus grande plateforme (hub) hors USA, avec 77 000 m2 d ’ e n t repôts et 2 000 personnes qui seront employées en 2006. La France compte 27 aéro p o r t s s e c o n d a i res desservant 130 pays via 6 200 vols hebdomadaire s . II.1 Le territoire français, point d'entrée multimodal privilégié pour l’Union EuropéennePar voie routière, ferroviaire, fluviale 950 000 km de routes (dont 9 300 km d’autoroutes), parmi les mieux entretenues d'Europe et les moins encombrées (30 véhicules par km de routes contre 44 en moyenne dans l’Union Européenne et 65 pour l ’ A l l e m a g n e ) , • Les voies ferroviaires ont transporté en 2001 plus de 55 milliards de tonnes-kilomètres, dont plus de 20 % en transport combiné rail-route, soit une part de marché supérieure aux 14% européens. La France se trouve au cœur des projets de corridors de fret de la Commission Européenne avec le corridor (“Freeway”) Belifret qui relie la Belgique, le Luxembourg, la France, l’Italie et l’Espagne. L’ a v e n i r du fret ferro v i a i re étant au multimodal, la SNCF Fret et le fabricant de wagons Lohr ont développé une technique originale, Modalohr, qui permet un chargement rapide et autonome de camions complets. Ce p rocédé sera expérimenté avec l’autoroute ferro v i a i re alpine entre la Savoie et le Piémont entre 2002 et 2 0 0 6 . • Les voies fluviales avec la Seine et le Port autonome de Paris, 2 è m e d ’ E u rope derrière Duisburg , l’ensemble Rhône-Saône, les canaux du Nord, du Rhin, soit plus de 58,7 millions de tonnes et près de 7 milliards de tonnes kilomètres en 2001. En France, le gro u p e m e n t Logiseine transporte en moyenne annuelle, 32 000 conteneurs EVP entre Le Havre et Paris Gennevilliers par convois fluviaux de 132 à 264 EVP. Rhône Saône Conteneur (filiale de CMA-CGM) est associée au développement d’un “magmaparc” de 500 000 m2 construit au Port de Pagny sur la Saône en Bourgogne, développé par Gazeley, filiale de Wal-Mart. L’expertise française en matière de transport fluvial est également reconnue sur des fleuves étrangers, aux USA ou en Amérique du Sud, avec la société Touax, créée en 1853, qui opère sur le Mississipi ou l’Amazonie, ou encore CFNR (Compagnie Française de Navigation Rhénane) qui opère sur le Rhin, la Moselle, le Danube et transporte plus de 13 millions de tonnes/an. Selon M. W. Smith, PDG de FeDex >>> “L’aéroport de Paris CDG est l’un des aéroports les mieux gérés d’Europe et le centre géographique du continent ”II.2 Des plates-formes de plus en plus “intelligentes” Le Sud-Est Les pouvoirs publics et économique de la région lyonnaise ont une politiqu volontariste en matière de logistique Sous le label "Lyon Logistics", i l s conduisent une politique de promotio commune à l’international, mettant e avant les atouts de leur région. Cett stratégie a été couronnée de succè avec les implantations de trè nombreuses entreprises d’importanc i n t e r n a t i o n a l e. Le logisticien japonais, New Wa v e Logistics (filiale de l’armateur NYK exploite un entrepôt de 20 000 m2 p o u r le compte de Yamaha Motors à Ly o n l’Isle d’Abeau. Koyo Steering Europe, leader mondia des systèmes de direction automobiles a décidé de construire son nouvea siège et centre européen de R&D dan la banlieue sud de Ly o n . DaimlerChrysler a construit un centr de distribution à Etoile-sur- R h ô n e (Département de la Drôme). En 2001, les retombées des activité logistiques pour la région lyonnais ont été estimées à plus de 9 milliard de francs, avec 46 sites de plus d 10 000 m2 créés en 5 ans, r e p r é s e n t a n t 4 000 emplois. L’Ile de Fr a n c e, pôle le plus développé de France avec 955 millions de m2 d’entrepôts et 12 millions de consommateurs, est la destination privilégiée des projets d’implantation. Les zones portuaires de Marseille-Fo s, du HavreR o u e n , de Dunkerque, et les zones aéroportuaires de Roissy CDG, M a r s e i l l e M a r i g n a n e, Lyon Saint-Exupéry, Va t r y, Châteauroux-Déols lié à A D P, confirment leur vocation de pôles logistiques. Certaines sociétés s’implantent en lisière de la “banane bleue” près des nœuds ferroviaires, autoroutiers ou fluviaux dans les régions : e n N o r d / P i c a r d i e, en Lorraine, en Champagne et dans le Sud–Est. Le Nord Pas-de-Calais Situé au centre de l’Euro-région, créée en 1991 avec le Ke n t , la Flandre, la Wa l l o n i e et Bruxelles-Capitale, le Nord Pas-de-Calais constitue le deuxième pôle logistique de France avec des dizaines de plates-formes dont celle de Dourges multimodale, d e 260 ha, aménagée par Logistis et Prologis. Cette Région a déjà accueilli plus de 500 investisseurs renommés qui emploient plus de 75 000 personnes ayant fait du Nord leur European Distribution Center comme Toyota à Onnaing-Va l e n c i e n n e s, Mercedes Benz à Rouvignies, V i s t e o n , C o n n a i r / B a b y l i s, Columbia Sportswear à Cambrai, B r i d g e s t o n e / Firestone à A m i e n s, S c h e r i n g, S i e m e n s, C o c a - C o l a , US Robotics, e t c. Véritable nœud des schémas logistiques, la plate-forme est sortie de son statut réducteur de simple entrepôt. Tout autant que sa conception, son implantation est un choix déterminant de la performance de l’entreprise. Au sein de la chaîne logistique et aux points de contact entre fournisseurs, p roducteurs et distributeurs finaux, il est nécessaire d’avoir recours à des platesformes logistiques, pour croiser les flux d’informations et traiter les flux physiques correspondants. Même le “e-commerce” , domaine du virtuel, ne peut f a i re l’économie de ces entrepôts intelligents. Gérés directement ou par l ’ i n t e r m é d i a i re de pre s t a t a i res externes (3PL), les entrepôts dépassent aujourd ’ h u i la seule dimension d’espace de stockage. Aux activités classiques de préparation de commandes se sont ajoutées des opérations de personnalisation des pro d u i t s au dernier moment ou diff é renciation re t a rdée, de conditionnement, de gestion des formalités administratives ou douanières. Les métiers au sein des platesformes sont de plus en plus variés et font appel à des spécialistes de la logistique, de l’informatique de réseaux… Compte tenu de ces enjeux, les décideurs des entreprises doivent faire des choix pertinents quant à leur localisation, et évaluer la qualité des infrastructures de dessertes, les potentiels humains… L’Est/La Lorraine La Lorraine dispose de très nombreux sites logistiques exceptionnels comme les plates-formes multimodales de Nancy, Eurotransit d’Ennery, le Pôle Européen de Développement, et de Metz choisis par des acteurs mondiaux. - Ikea a établi à La Maxe une plate-forme logistique d’une capacité de stockage de 165 000 m3 , gérée par le prestataire logistique Norbert Dentressangle Logistics. - Cat Logistics, filiale de Caterpillar Inc, a choisi la Lorraine dès 1993, pour gérer les flux de ses clients Chrysler, Land Rover, H i a b, Electrolux… dans un entrepôt logistique de 32 000 m3 . - GE Lighting s’est installé sur la plate-forme Eurotransit à Ennery. - Tenneco A u t o m o t i v e, équipementier en systèmes d’échappement et de suspension, est situé à Fameck (Moselle). - Smart (SCC) a implanté son centre logistique mondial à Hatten (Bas Rhin). Les zones portuaires Le PAM (Port Autonome de Marseille) s’est doté d’une zone logistique à Fos de 160 ha, dénommée “ D i s t r i p o r t ” , sur laquelle sont pré- sentes les sociétés Danone, Kawasaki et son centre de distribution géré par Lorafret et P&0-Nedlloyd, Dole Fo o d s, le logisticien T N T. Depuis 1999, la plate-forme multimodale de 260 ha “ C l é s u d ” a été choisie par Rexel. Nortène (par les prestataires logistiques La Flèche et Giraud Logistics) complète ces installations. Prologis a créé 125 000 m2 de plates-formes logistiques sur le site du Hode (Le Havre). A Rouen, le géant anversois We s t e r m u n d , premier distributeur de produits forestiers au monde, a installé un terminal de 13 500 m2 p o u r ses clients UPM, Kymene ou M-Real afin d’exporter sa pâte et son papier kraft jusqu’en Chine. Dunkerque accueille sur sa plate-forme multimodale de 20 ha, quelques fleurons de l’industrie mondiale comme C o c a - C o l a , Dupont de Nemours, C y n a m i d ,A j i n o m o t o, N u t r a s w e e t , P é c h i n e y, Maersk Logistic, Lego et Fa l c o n . B retagne s 7 Ü16 349 Pays de la Loire s 1 9 Ü65 100 L i m o u s i n s 2 Ü18 500 A q u i t a i n e s 2 0 Ü92 447 M i d i - P y r é n é e s s1 8 Ü84 000 P o i t o u C h a re n t e s s7 Ü28 000 C e n t re s 2 8 Ü346 317 P i c a rd i e s 9 Ü64 650 Ile de France s 1 0 1 Ü956 000 L o r r a i n e s1 9 Ü64 700 B o u rg o g n e s1 1 Ü34 200 A u v e rg n e s3 Ü1 000 L a n g u e d o c R o u s s i l l o n s 6 Ü49 200 C h a m p a g n e - A rd e n n e s s1 2 Ü65 000 A l s a c e s 1 4 Ü82 640 Franche Comté s3 Ü3 2 5 R h ô n e - A l p e s s39 Ü258 000 PACA P rovence-Alpes-Côte d’Azur s2 2 Ü174 200 Haute-Normandie s 1 8 Ü85 500 s N o m b re de sites pre s t a t a i res logistiques ÜSurfaces totales d’entre p o s a g e S o u rce DATA R2 0 0 0 B a s s e - N o r m a n d i e s 4 Ü9 3 0 N o rd - P a s - d e - C a l a i s s4 3 Ü289 225 Sites et surfaces logistiquesLes spécialistes de l’immobilier logistique Pour concevoir et construire ces plates-formes clés en main, les investisseurs peuvent s’appuyer sur l’expertise de grandes entreprises de travaux publics. Et si le leader mondial de l’entrepôt logistique, l’américain Prologis, est très présent en France depuis le rachat de Garonor (450 000 m2 ), les sociétés françaises sont bien implantées sur le marché. Bouygues et sa filiale spécialisée Parcolog, ont en projet la construction de dix grands parcs logistiques d’ici à 2005, soit 550 000 m2 . GSE gère un parc de 8 millions de m2 implantés dans 12 pays. Logistis, filiale de la Caisse des dépôts, gère un parc de 600 000 m2 d ’ e n t repôts construits. Sogaris, l'initiateur en France des plates-formes logistiques avec Rungis, dispose d’un parc de plus de 350 000 m2 à Ly o n , Rouen, Bayonne et est engagé au Havre dans un projet de 200 000 m2 pour le parc logistique du Pont de Normandie. Issues du monde du bâtiment et des travaux publics, ces entreprises ont su accompagner l’évolution du secteur logistique pour devenir de véritables spécialistes de l’ingénierie des plates-formes. La “Banane bleue” La “Banane bleue” constitue le cœur économique de l ’ E u rope communautaire (2/3 du PNB). Les régions de France limitrophes (du Nord, de l’Est, du Sud-Est) sont bien placées en périphérie pour la localisation des plates-formes logistiques car ces zones sont moins saturées qu’au sein de la “banane”. Un arc secondaire de développement part de la région du Havre, englobe la région parisienne, la B o u rgogne, le Lyonnais et le bassin rhodanien, jusqu’à Marseille ; un arc similaire se dessine à l’Est de la “banane” depuis Hambourg jusqu’à Vienne, en passant par Berlin. Composantes financières d’un “parc logistique” de 20 000 m2 Coût du foncier : 2 millions d’_ + coût de la construction : 5 millions d’_ = 7 millions d’_ au total ou bien un loyer annuel de 0,82 million d’_ (41,16 _ par m2 ) Ces coûts de construction élevés s’expliquent par le “traitement tertiaire“ des entrepôts insérés dans des ensembles paysagers soignés avec arbres, pelouses et massifs de fleurs, comportant : • des dispositifs de sécurité au vol et au feu, • l’ergonomie des lieux de travail, • l’éclairage de 150 lux dans les zones de stockage, de 200 lux dans les zones de préparation, de 250 lux dans les bureaux ; éclairage zénithal par le toit plus agréable représentant 6% de l’éclairage total, • le chauffage, avec une température minimale de +7° dans les entrepôts. Dans l’avenir, les besoins en termes d’infrastructures de stockage et de distribution, liés au développement de l’e-commerce pourraient faire apparaître de petites surfaces plus proches des grandes agglomérations, avec pour conséquence un foncier encore plus cher. Un signe précurseur, en avril 2001, une plate-forme “ t é l é h o u s i n g ” de 16 000 m2 a été mise en service pour la première fois à Garonor (Paris) regroupant l’ensemble des équipements de communication de transaction par Internet nécessaire aux cyber-commerçants présents sur ce site.II.3 Les gestionnaires des plates-formes : 3 PL, 4PL, LLP Si la logistique devient de plus en plus importante dans la gestion d’entreprise, elle requiert dans le même temps de plus en plus de moyens. Afin de ne pas disperser leurs actifs et de rentabiliser au mieux leurs investissements, les entreprises externalisent de plus en plus leur chaîne logistique. Leurs partenaires traditionnels, comme par exemple les sociétés de transport, ont ainsi élargi leur off re, se transformant en véritables partenaires logistiques appelés 3PL (Third Party Logistics). Sur d’immenses plates-formes logistiques qui leur permettent de bénéficier d’économies d’échelle, les 3PL gèrent les stocks de leurs clients, préparent les commandes des clients, conditionnent les p roduits, ou accomplissent les formalités douanières. Le mouvement de recentrage sur les activités du cœur de métier des entreprises a également affecté l’activité logistique. En délaissant cette fonction, les entreprises ont permis à un véritable marché de la prestation de services d’apparaître dans le secteur, notamment dans la gestion des plates-formes. C AT conseil, filiale de CAT logistique, est un LLP qui aide ses clients comme Alcatel, Aussedat, Digital, France Télécom, Lafarge, La Poste, Renault, Sommer, Wheelabrotor, à mettre en place des schémas directeurs et de stratégie logistique sur l’Europe. La société Bils Deroo, avec un chiff r e d ’ a ffaires de 833 millions _ en 2001, et 1 800 personnes sur 40 plates-formes totalisant 450 000 m2 , illustre bien cette participation d’un 3PL à l’optimisation de la logistique amont. Pour le compte des usines Renault à Douai ou pour PSA, elle eff e c t u e : l le montage et la distribution de roues de secours l la distribution de pièces toutes les 2 heures sur la chaîne automobile de 1 000 voitures/jour en JAT grâce à 200 véhicules dotés du téléphone embarqué l la tenue de stocks de sécurité de housses de sièges, de tôlerie, de pneus avec un délai de réaction de 10 minutes à 4 heures l la primarisation des pare-brises en salle blanche, avec apposition de pré-colle autour des verres avant le collage en usine l les tests de qualité sur articles en VPC, le montage des pneus sur jante, le conditionnement des pneus pour l'export. La société Daher, créée vers 1880, réalise désormais le 1/5 e de son chiffre d’affaires en prestations logistiques (1 57,17 millions _ sur 760 millions _ en 2001) avec un effectif de 2 205 personnes dont 550 en logistique. Elle gère 675 000 m2 d’entreposage sur 5 sites. Daher dispose d’un bureau d’étude de 60 ingénieurs, dont 40% en aéronautique. Dans ce secteur, Daher effectue des transports de tronçons d'avion sous contrôle permanent par balisesatellite pour Airbus et ATR, ainsi que la préparation et le montage des trains d'atterrissage de l'A300, sous agrément qualité AIRBUS INDUSTRIE (Daher étant sous norme ISO 9002 depuis octobre 1994). Dans le secteur chimique, Daher dispose de 21 000 m2 d ' e n t repôts classés à Rognac, sur le site de Berre, pour le compte d'AT O , de BP, de CECA, d'HOECHST, de SHELL, de SOLVAY, etc. Dans l’automobile, Daher stocke, prépare, livre sur chaîne de montage les produits de SIV, fabricant de vitrages pour les constructeurs automobiles français. Pour TECHNIP, Daher a contribué à la construction d'une raffinerie à Omsk en Sibérie Occidentale, avec transport de colis lourd de 55 m et de 2 700 tonnes, de Lyon à Fos par barge fluviale, puis par navire bigue via le port russe d'Arkangelesk, puis à nouveau par b a rge fluviale jusqu'à Omsk. Le transport ne représentait que 7% du devis global. Toujours en Russie, Daher a participé au pro g r a m m e d’informatisation de l’administration fiscale russe (ISIMPOL), en assurant la logistique de livraison des o rdinateurs BULL, dans des wagons soudés et suivis par satellite.Des sociétés comme Cat, Gefco, Heppner, Faure et Machet Logistic, interviennent dans le processus de production des produits, en personnalisant les produits selon les besoins des clients. Les 3PL peuvent en fait participer à la gestion des flux de l ’ e n t reprise à chacune des étapes de la chaîne. Que ce soit en amont pour gérer les relations avec les fournisseurs, en interne pour alléger la chaîne de production de l ’ e n t reprise ou en aval pour optimiser la distribution des produits. Mais si les 3PL prennent une importance croissante, leur activité demande d’importants investissements en moyens logistiques. Les 4PL, apparus plus récemment, interviennent uniquement dans la planification de la chaîne logistique. Ils mettent en œ u v re des moyens intellectuels et informatiques pour la définir et l’optimiser. Ils sélectionnent les sous-traitants qui interviendront et assument la responsabilité des prestations de ces derniers. Les français Freelog, Baliseo.com ou encore PEA Consulting, conseil en organisation industrielle et logistique, sont positionnés sur ce créneau particulier. A mi-chemin entre ces deux approches, les LLP prennent en charge la logistique de leurs clients en combinant les moyens pro p res dont ils disposent (rôle de 3PL) avec la gestion d’un réseau de pre s t a t a i res qu’ils ont défini (rôle de 4PL). La société Faure et Machet Logistic (FML), issue du transport de bois et de matériaux de construction, a réalisé en 2001, un chiffre d ’ a ffaires de 305 millions _, avec 5 7 2 1 personnes et 25 entrepôts en France. Elle propose à ses clients des systèmes de pro d u c t i o n avec diff é renciation re t a rdée (co-manufacturing et conditionnement à façon) pour abaisser les niveaux de stocks et les coûts de ses clients : comme Mars à Brumath, HP à Saint Quentin Fallavier et Metz, Crépy en Valois pour Henkel. Giraud Logistics et Giraud Transport, ont réalisé en 2001 un CA de plus de 800 millions _, avec 6 500 collaborateurs et 120 implantations à l’international, dans 13 pays avec une gamme de services logistiques étendue. Giraud Logistics assure pour ses clients l’entreposage et la gestion de stock avec 8 500 000 m2 d ’ e n t repôts, la préparation de commande, l’assemblage et le montage, les opérations de pré et postmanufacturing, le conditionnement à façon et co-packing, les approvisionnements en juste à temps, la gestion partagée de l’information, avec des outils comme GEDILOG pour optimiser et piloter la logistique de flux et d’entrepôt, l’EDI, les codes- barres et le contrôle pondéral.II.4 L’ industrie française de la manutention L’industrie française off re une gamme complète et variée de matériels, logiciels, systèmes et services, recensée par le Syndicat des Industries de Matériels Manutention (SIMMA), qui couvre tous les besoins d’équipements de ces plates-formes intelligentes.Ce qui fait de la France l’un des leaders mondiaux dans ce secteur. Les nouveaux produits permettent par exemple d’augmenter les capacités de stockage au mètre carré, afin de rentabiliser l’espace de stockage par le biais de rayonnages et stockages dynamiques (Duwicquet, Euro s t o c k , Féralco, Mecalux, Prodex). Les systèmes de préparation de commandes, de tri, les transtockeurs, monorails (Siemens Dematic), les palettiseurs (Mepal), les transpalettes (MIC/Jungheinrich), les palettes (Allibert, Sameto Technifil) et les convoyeurs facilitent la manutention des produits. Pour équiper ces plates-formes, où s’effectuent les opérations physiques de stockage, de manutention couplées avec le traitement des informations en temps réel (manutique),la France a développé une importante industrie de la manutention re g roupant plus de 320 entreprises, employant plus de 24 000 personnes pour un CA de 4,5 milliards d’euros en 2000, dont 38% à l’exportation. Pour faciliter les opérations au sein des plates-formes logistiques,les outils de manutention ont connu d’importantes évolutions au cours des dernières années. L’objectif principal est de rendre l’opération plus rapide, en apportant plus de sécurité au manutentionnaire.ur les charges plus importantes, les matériels de levage : les manipulateurs (Dalmec), les ponts roulants (ADC oupe FAYAT, Europont, Demag, Abus-Standlev), les nacelles (Pinguely Haulotte, Manitou), les treuils (Huchez, actel), les palans (Verlinde), les crics et vérins (SSVH), les retourneurs de charge (Topal Industries), mais aussi s systèmes pour charges isolées suivent aussi cet objectif de re n d re la manipulation des marchandises plus mple et plus sûre. s moyens s’automatisent avec les chariots sans conducteurs (B.A Systèmes, Savoye Logistics) et les systèmes tomatiques de manutention de charges isolées. lon le SIMMA, pour piloter et réaliser les diff é rentes phases de mise en œuvre de ces projets et garantir un sysme global et cohérent répondant aux enjeux et aux performances attendues, les ensembliers-concepteurs ou égrateurs comme Alstef Automation, Savoye Logistics, Siemens Dematic, Vanderlande ont rédigé, à l’initiative SIMMA, un manifeste des meilleures pratiques pour réussir un projet de manutention automatisée. Ces indusriels s’engagent sur les performances des systèmes fournis, compris pour l’intégration informatique. La révolution dans la logistique p rovient des capacités nouvelles apportées par l’informatique dans le stockage de gestion de bases de données (SGDB) et de leur traitement par divers logiciels informatiques. Ces outils permettent soit de faire communiquer entre elles d i ff é rentes fonctions dans l ’ e n t reprise, soit de s’adre s s e r plus spécialement aux activités logistiques. Ils permettent également d’intervenir sur les flux au cours du processus de pro d u c t i o n . Les ERP, outils transactionnels Outils internes à l’entreprise, qui ont permis l’automatisation des fonctions (paye, comptabilité, achats, production), les ERP, ou PGI, sont constitués de gigantesques bases de données communes (SGBD). Multi-sites, disponibles à tous les échelons décisionnels, ils permettent d’organiser les échanges d’informations au sein de l’entreprise. Dans ce domaine, des éditeurs français comme Cegid, Focal, Ordirope ou Qualiac ont mis d’excellents outils PGI à disposition des moyennes et grandes entreprises. Mais si les ERP gèrent les processus à l’intérieur de l’entreprise, les SCM sont tournés vers l’automatisation des processus liant l’entreprise et son environnement. Les informations échangées permettent à chacun de planifier et d’optimiser ses flux en tenant compte des besoins et disponibilités des unes et des autres. Ils viennent ainsi compléter les ERP en leur fournissant des données pertinentes pour prendre des décisions. Véritables outils d’aide à la décision, les SCM permettent d’optimiser les flux en fonction des contraintes extérieures, comme le proposent les solutions du français Générix et son logiciel GeneriX Execution ou du bordelais Edic et son logiciel Cormag. Les progiciels logistiques Pour réaliser une planification efficace des re s s o u rces, les ERP ont besoin d’informations fréquemment mises à jour. Les flux n o m b reux et variés au sein de l’entreprise et leur éclatement en diff é rents lieux sont autant d’éléments qui obligent à automatise la remontée des données pour éviter les pertes de données qui fausseraient la prise de décision. Les logiciels de SCE eff e c t u e n t une planification dynamique des re s s o u rces “passives” constituées des quais, des moyens de manutention, des re s s o u rc e s humaines et opèrent un lissage de charge permanent. A l’entrée en magasin, ils facilitent par exemple l’optimisation de l’emplacement des produits par rapport à leur valeur, leur poids leur volume, leur classe, leur caractéristique, leur dangerosité. Ils optimisent les stocks, selon la méthode LIFO/FIFO pour le logicie Stockexpert de CEG informatique ou selon la rotation ABC pour le logiciel LM Stock Optimizer de l’éditeur Logarithme ou encor selon l’attribution dynamique des classes de stockage (ADCS) mis en place par le leader mondial Hardis (et l’Universit de Grenoble), avec ses logiciels Adelia 400 et Reflex adoptés notamment par MacDonald’s. Les SCE peuvent aussi gérer l’activité des caristes (Reflex), le pilotage des automates avec le logiciel Infolog GE WMS d DL Consultants, optimiser la gestion du parc de véhicules, des tournées avec Acteos et ses logiciels Logiroute, ou C2G et son logiciel Eurotrans. Les communications peuvent se faire en temps réel via les réseaux à valeur ajoutée (EDI), Internet par radio fréquence ou le satellite, avec une multitude d’éditeurs français spécialisés sur la gestion d’entrepôts ou le transport comm CLE 128 (Géode), GFI Info (Magellan), Infflux (Alice), KLS (Gildas). Alors que les flux de l’entreprise deviennent plus nombreux et plus rapides, l’informatique s’impose comme l’outil incontournable pour assurer le traitement des informations liées aux opérations logistiques. II.5 Développeurs de solutions informatiques (SCM) Logiciels décisionnels ou BI (Business Intelligence) > > > Les PGI/ERP, conçus à l’origine pour optimiser les systèmes de production, n e permettaient pas d’aider à la prise de décision. Ils ont été peu à peu couplés à de outils connexes d’aide à la décision (Business Intelligent ou APS*) qui transforment le données en informations pertinentes, à l’instar de ceux développés par des éditeur français comme Ortems, ou Business Object, leader mondial établi tant en Fr a n c e, P a r i s, qu’aux USA, à San José dans la Silicon Va l l é e, choisi par des prestataire logistiques comme Calberson (Groupe Geodis) ou Danzas (DP). ILOG > > > La qualité de ces progiciels dépend en grande partie des moteurs de calcul qui utilisent des algorithmes dont les plus avancés sont fournis par le français ILOG qui regroupe une équipe de 480 personnes dans le monde, réparties sur 3 continents, et qui a pour client les plus grands éditeurs mondiaux d’ERP ou de SCM comme SAP, O r a c l e, P e o p l e S o f t , I 2 , D y n a s i s, JD Edwards… ou des industriels comme France Télécom qui utilise ILOG pour la supervision en temps réel de son réseau de 1 000 000 km de lignes de fibres optiques, ADP pour la gestion des aéroports de Paris : des pistes, des emplacements des parkings, des portes, d e s convoyeurs de bagages, intégrant également la gestion des contraintes climatiques, Chrysler pour la planification des opérations de peinture, e t c. Pour optimiser et localiser leurs flottes de véhicules, les transporteurs français s’appuient sur de grands opérateurs mondiaux comme France Télécom et sa solution Road on line. Bouygues Télécom s’octroie 20% du marché de la localisation. SFR-Cegetel fournit des plates-formes mobiles aux entreprises. Alcatel Space à l’aide de son système télématique de gestion de flotte Euteltracks, assure la transmission sécurisée de données sur toute l’Europe par le biais de deux satellites géostationnaires. L’échange de données pré-formatées, entre les mobiles et l’exploitation, vient alimenter en informations les nombreux logiciels français de “télématique ro u t i è re” disponibles sur le marché européen développés par des sociétés comme Aplus Informatique logiciel Traplus), C2G Informatique, CJM International (logiciel Transics). Ces diff é rents logiciels peuvent aussi assurer le suivi social des temps de conduite comme le permet le logiciel Clever route du cabinet Cleversys, associé au système d’information cartographique de l’éditeur Géoconcept et au moteur d’optimisation par contraintes d’Ilog ou encore le logiciel Optimal route de ’éditeur Inovia qui interdit le dépassement des temps réglementaires ou prévoit les pauses déjeuner, les temps de chargement et de décharg e m e n t . pour la gestion globale de la chaîne logistique (SCM) Les progiciels de gestion des flux de production La révolution logistique, parce qu’elle permet de faire varier la production en fonction des prévisions de vente, des flux d’approvisionnement, nécessite elle aussi une planification très fine de ses flux. La préoccupation devient l’abaissement des stocks, l’optimisation de l’utilisation des automates de p roduction. Des impératifs d’organisation pour l’essentiel adaptés des pratiques de l’industrie automobile japonaise. Des logiciels français de renom permettent d’apporter cette flexibilité à l’outil de production, de faire de la GPAO, comme le logiciel WES (multilingue) de la société Courbon, P rodstar d’Adonix, (avec plus de 1 000 sites installés) ou encore Step pro du breton BG Soft pour e suivi des temps et des événements en production. De grands cabinets de consulting en organisation et gestion de production comme Cogite Nord , Cybernetix, JMA Consultants, PMGI, apportent leurs concours aux entreprises pour les aider à r é d u i re leurs coûts de production, leurs temps de cycle, développer leurs produits, améliorer a productivité des usines, des bureaux d’études… Pour re n d re flexible et réactif l’outil de p roduction, il convient également d’optimiser la logistique amont d’approvisionnement (Kanban et JIT), de réagir en temps réel aux modifications de conception (extrême amont) et de participer à la réduction des coûts de retrait (rétro - l o g i s t i q u e ) .La logistique moderne modifie les rapports entre producteur et utilisateur final du produit, en offrant la possibilité de s’affranchir des intermédiaires. Mais cela fait peser de nouvelles contraintes sur la chaîne logistique. Logistique et personnalisation des produits Mais cette logistique, que l’on qualifie d’extrême amont, doit être intégrée dès les pre m i è re s étapes de l’élaboration du produit. Elle doit être associée en phase d’analyse de la valeur, pour indiquer au bureau des études et des méthodes, les contraintes logistiques modulaire s de forme, de poids, de volume, d’évolution de comportement des emballages des pro d u i t s en cours de transport ou de stockage. Le logisticien peut alors définir les moyens de transport et de stockage à mettre en œuvre afin de réduire les coûts. En effet 80 à 90 % des éléments influant sur le coût global du p roduit (LCC) sont mis en œuvre dès la phase de conception et 60 % de ce coût résulte du soutien logistique nécessaire au maintien des disponibilités tout au long de la vie du pro d u i t et lors de son retrait du marché. Ce dernier élément est l’autre élément fort de la logistique actuelle. Le producteur doit prévoir très tôt le processus de retour du pro d u i t . L’une des possibilités offertes par les nouvelles technologies de communication et l’informatique est l’intervention du client final dans la chaîne logistique. S’il peut actuellement passer d i rectement sa commande, l’innovation principale est la possibilité qui lui est offerte de modifier et personnaliser le produit acheté. Il peut ainsi ajouter des options comme choisir la couleur. C’est ce que proposent des sociétés comme Dell pour une commande d’ord i n a t e u r par Internet ou Renault qui souhaite s’engager à servir son client sous 15 jours maximum, quelle que soit la combinaison des options. III. Logistique d’extrême amont et rétro-logistique> > > Tridex travaille avec le prestataire logistique Tibett & Britten pour les liquides, et procède à des opérations de tri, de déconditionnement, de reconditionnement éventuel, d’enlèvement des étiquettes et à la réexportation sur d’autres pays en second marché. Les verres, c a r t o n s, a l u m i n i u m , p l a s t i q u e s, fer blanc sont triés, stockés et vendus à la société ONYX. La logistique de retour En supprimant les intermédiaires, la logistique d’extrême amont doit veiller à gérer le re t o u r des produits pour des problèmes de maintenance. Mais avec le développement du commerc e é l e c t ronique, le client dispose d’un droit de rétractation après réception du produit. Dans les deux cas la pro c é d u re de retour du produit doit être prévue de manière à limiter l’implication du client final dans cette tâche et, dans certains cas, sa participation aux coûts. A ce niveau aussi la réflexion logistique doit s’intégrer dès l’élaboration du pro d u i t . Dans la même optique, les lois environnementales imposent de plus en plus au fabricant de suivre son produit durant toute sa vie, à l’aide de logiciels appelés PLM d’Agile software ou Syncra, de le re t i rer du marché, en fin de vie, s’il n’est pas entièrement biodégradable, ce qui entraîne de nouveaux surcoûts logistiques. Des cabinets français se spécialisent dans cette discipline comme DIB Consultant, conseil en gestion globale de filières déchets, avec pour clients les groupes sidérurgiques européens, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), OCP répartition, Logidis, FML, Auchan, Leclerc, Castorama, UGAP (Union des groupements d’achats publics). Des 3PL ont développé des filiales spécialisées comme G2R (pour Géodis Recyclage Revalorisation), filiale du leader français Géodis qui organise la fin de vie des ord i n a t e u r s , photocopieurs, téléphones, centraux téléphoniques pour France Télécom, Bouygues Télécom, Rank Xeros, Toshiba, etc. Des industriels de la filière environnement se positionnent également sur ce marché du retraitement et de la valorisation des déchets comme Conibi qui p rend en charge les déchets bureautiques et informatiques pour Canon, Epson, HP, Konica, Minolta, Sharp,… ou Tridex, qui gère les retours des produits périmés, pour Gillette, BASF, Coca-Cola, Orangina.IIII. E-logistics ou infogistics Les places de marché transactionnelles se sont également préoccupées des problématiques logistiques. Si le commerce électronique a ouvert de nouvelles perspectives aux entreprises, il donne un poids nouveau au client final dont les exigences pèsent plus fortement sur l’activité du producteur. La logistique du e-commerce s’adapte en devenant de plus en plus une affaire de spécialistes. La montée en puissance d’Internet a transformé en p rofondeur les relations client-fournisseurs, tant en B2B qu’en B2C, en conférant encore plus de pouvoirs à un cyber-client éduqué qui entend, désormais, disposer plus rapidement d’un produit dont il peut définir les qualités. Si l’achat se passe dans un univers virtuel, les préoccupations du consommateur sont, elles, parfaitement concrètes. En particulier, le client internaute ne supporte pas le moindre défaut dans la livraison que cela soit au niveau du délai ou de l’intégrité des produits commandés et une nouvelle forme de logistique est apparue, qualifiée d’infogistics ou e-logistique. Les sites Internet n’ont pas immédiatement perçu l’importance à accorder à ce soutien logistique, a c c o rdant leur attention au paiement sécurisé, au graphisme du site, au catalogue. Comme l’a souligné M. Soriano, Président de l’Irepp (Institut de re c h e rc h e s et perspectives sociales), les start-up ont, au début, traité “la logistique par défaut avec des moyens luxueux” en n’imputant pas les coûts réels de logistique attachés à cette nouvelle technique de distribution, soit par stratégie de conquête de nouveaux clients, soit par mauvaise estimation de ces coûts. > > > Des 4PL qualifiés d’ " i n f o m é d i a i r e s " , c o m m e Freelog, Baliseo sont apparus dans la "e-chain" pour aider les cyber-commerçants à choisir leurs intervenants et le type de prestation logistique le mieux adapté.Les acteurs de l’e-logistics Ces contraintes logistiques ont pu être surmontées en France, avec des méthodologies différentes par les grands groupes de distribution, comme Auchan, Carrefour-Promodès, Casino, Cora Galeries Lafayette… qui ont créé des sites Internet comme Ooshop.com, Houra.fr, Telemarket, numéro un français du supermarché, en se servant de leur expérience logistique traditionnelle. Les vépécistes classiques comme La Redoute/ Redcats, La Camif, Les 3 Suisses, Yves Rocher et sa filiale Distrihome, ont su mettre à profit leur expérience de la livraison aux particuliers. La Poste avec ses 14 000 bureaux et 90 000 facteurs, est devenu un prestataire de services apprécié des acteurs du commerce électronique. Outre sa présence sur le territoire français, elle peut s’appuyer sur ses filiales européennes (Denkhaus, Birkhart, Interspe en Allemagne, Parceline et Interlink Express en Grande Bretagne et Irlande), voire INSA aux USA, et sur ses accords avec Geodis, FedEx, et les Postes italiennes, portugaises et grecques. Certains 3 PL développent une spécialité sur le m a rché de l’e-logistics. Geodis, leader français et quatrième transitaire européen, a conclu une alliance avec France Télécom et son site marc h a n d T é l é c o m m e rce. Mory Team a créé une joint-venture avec Elia ( Team-on-line), l’éditeur de logiciels spécialisés dans le transport, pour offrir un traitement logistique adapté au web. Heppner pour sa part a passé un a c c o rd avec une start-up américaine, Escalate, fournisseur de prestations dans le e-commerce. La société Staci réalise 90% de son activité à partir du We b . Par sa filiale Publi-Tr a n s / E u r o d i s p a t c h , La Poste, qui dispose de 150 000 m2 d e stockage sécurisés, a créé un pôle intitulé "La Poste Commerce Electronique", qui propose des solutions de transport et de logistique adaptées aux attentes de ses cyber-clients (Alapage. c o m , A q u a r e l l e. c o m , F n a c. c o m , S i e m e n s, 3 Suisses,..). Publi-Trans effectue le colis a g e, la préparation de commande, l e s expéditions en colis express avec C h r o n o p o s t , en colis rapide avec C o l i p o s t e, voire l’affacturage.IIIII. Logistique collaborative Parce que la planification logistique a besoin d’informations fiables et précises pour avoir un sens, les entreprises sont conduites à échanger entre elles des données qu’elles gardaient jalousement jusqu’alors. Cette logistique collaborative inaugure de nouveaux partenariats gagnant-gagnant. Assise sur les fonctionnalités des progiciels PGI/ERP et SCM, la gestion collaborative permet de faire communiquer les différents sites d’entreprises impliquées dans une chaîne logistique et ce en temps réel. Les bénéfices de ce mode d’organisation sont partagés par tous les acteurs. Les tensions dans les relations client-fournisseur se trouvent réduites, les coûts sont optimisés. Les ERP, outils transactionnels En amont, la gestion collaborative avec les fournisseurs permet une très grande réactivité et la réalisation d’économies dans les transactions d’achats et d’approvisionnement. Les logiciels SCM d’exécution, qualifiés de GRF (Gestion de la Relation Fournisseurs ou SRM en anglais), permettent par exemple l’identification des fournisseurs (sourcing), leur qualification selon la taille critique et leur capacité à livrer JIT, la négociation, le lancement des appels d’off re s d i rects ou inversés, la sélection (short list) ou l’évaluation des performances du fournisseur avec son taux de risque fournisseur avec des outils décisionnels de Business Object, et son logiciel Source Analytis. En aval, la logistique collaborative entre producteurs et distributeurs et au-delà le client final, est définie par l’acronyme CRM (Customer Relationship Management). Ces logiciels permettent de c o n f ronter les prévisions de ventes aux contraintes de l’ensemble de la chaîne (capacités de production, de transport, niveau des stocks…). L’éditeur français CJM off re, à cette fin, une solution multi-sites, multi-entre p ô t s . A u t re composante logistique de l’ECR, la Gestion Partagée des Approvisionnements (GPA) ou Supply Management Inventory (SMI). A partir du moment où le fournisseur accède en temps réel à des remontées d’informations journalières, il lui est possible d’abaisser les niveaux de ses stocks de sécurité, en lançant des ord res de fabrication couvrant les taux de rupture anticipés, de faire des suggestions de réapprovisionnement continu validées par le client-distributeur (CMI ou Co-Managed Inventory) ou sous la responsabilité du seul fournisseur (VMR/VMI ou Vendor Managed Replenishment/Inventory).Les fournisseurs reçoivent chaque soir par EDI les données fondamentales et confidentielles relatives aux entrées et sorties des entrepôts de leurs clients qui doivent être traités par des logiciels. Les principaux éditeurs français s’appellent Alamacon, Atos, Everest informatique, Syntégra, Unilog et plus particulièrement Influe (logiciel EWROne), leader mondial des solutions de GPA, avec 50% de parts de marché et 4 500 clients à travers le monde. Pour anticiper e n c o re davantage les événements qui peuvent survenir chez les diff é rents partenaires, rupture de stock, arrêt de production, grève des transporteurs, des logiciels dénommés SC Event Management assurent le tracing des produits et la gestion des alertes, comme celui de l’éditeur français Ortems. Mais, malgré leur intérêt réel, ces solutions apparaissent difficiles à déployer pour les entre p r i s e s . Mettre en place une logistique collaborative La difficulté de cette gestion logistique collaborative consiste dans la compatibilité des diff é rents logiciels (ERP, SCM, SRM, ECR, SCE). L’interfaçage se fait à l’aide de plates-formes techniques, gérées par des logiciels dits EAI (Enterprise Application Integration) ou OAI (pour Open Application Integration), comme celui développé par les éditeurs français Logarithme qui off re une gestion décisionnelle multi-sites. GFI propose une solution qui assure une gestion interfaces EDI/MRP. Le logiciel de DynaSys re g roupe toutes les technologies de connexions aux ERP. ESKER, l’éditeur français le plus présent aux USA, développe des progiciels de communication entre toutes les NTIC. Mais outre ces réels problèmes techniques d’interface entre les logiciels, les véritables difficultés dans la mise en place de cette gestion collaborative sont en fait, les changements à apporter dans les mentalités car il faut décloisonner en interne les “silos” fonctionnels, et changer les comportements d’aff rontement qui peuvent subsister dans les rapports clients/fournisseurs en externe. Le recours à des sociétés de conseil en management logistique permet souvent de conduire et d’accompagner le changement. Selon P. Eymery, Président de l’ASLOG*, “leur rôle est de proposer le changement, le concevoir, l’accompagner, guider dans l’univers toujours plus complexe des technologies” . Dans l’avenir, le rôle et le métier de chacun des intervenants de la chaîne logistique devraient être complètement transformés. Les industriels gére ront de plus en plus des données d’informations puisées directement chez leurs distributeurs. Les pre s t a t a i re s logistiques traiteront les flux de marchandises avec des ventes départ usine et le re g roupement sur un même site de plusieurs industriels et distributeurs (cross-docking). Distributeurs et industriels devront travailler de façon conjointe, opérer des r é a p p rovisionnements basés sur les ventes (GPA) et non plus sur une logique de gestion de stocks (ERP), et élargir la chaîne d ’ a p p rovisionnement en intégrant les prévisions (CPFR) et en anticipant les évènements (SC Event Management).G l o s s a i r e Les progiciels de gestion des flux de production Sociétés de conseil françaises citées en raison de leur taille, de leur ancienneté et de leurs niches de spécialisation : • Altis, Clé 128, Sofresid ou encore Diagma, consultants et éditeurs de logiciels SCM, Valtech Axelboss, leader du conseil en logistique et SCM sur le marché français avec une forte pré- sence à l’étranger, Newton Vauréal. • SSII françaises de réputation mondiale : Cap Gemini, Sopra, Unilog, qui ont également des équipes d’experts renommés en stratégie logistique et comptent de nombreuses références internationales en matière de transformation de processus logistique. • Spécialistes du conseil en entrepotique et transitique : JP2, conseil en conception et restructuration de centres de distribution ou d’entrepôt ou Logistock, spécialiste en ergonomie de poste de travail,de préparation de commandes, de transfert automatique par chariots robotisés, en transfert de poste à poste. • Spécialistes de l’adéquation de l’outil de production à la flexibilité des variations du marché : Artemis International ou Ouroumoff Diffusion, conseil en organisation industrielle et logistique, éditeur de Preactor, outil qui a permis de démocratiser la simulation des flux de production et l’ordonnancement à capacité finie, vendu à 500 clients sur les 5 continents. • Spécialistes en gestion du plan transport : Ecal ou GFI Informatique (logiciels Ulysse et Magellan) ou Wilogs (racheté par Freelog). • Spécialistes des interfaces de flux d’informations entre les différents acteurs de la SCM comme le leader mondial Influe, qui a développé une gamme de moteurs logiciels EDI permettant à des partenaires économiques d’échanger des documents commerciaux, financiers, administratifs. Extrait du Guide de l’ASLOG 2001 Association des Logisticiens 3PL Third Party Logistics : s o u s - t r a i t a n t s d’exécution classique qui gèrent et exécutent une fonction logistique spécifique en utilisant ses p ro p res actifs et re s s o u rces pour le compte d’une a u t re société. 4PL Fourth Party Logistics : sous-traitants de planification qui n’ont pas de moyens pro p res mais pilotent, combinent, optimisent et sous-traitent l’ensemble des flux physiques et d’informations de leurs clients. APS Advanced Planning System : s y s t è m e s dédiés à la gestion de la chaîne logistique collaborative qui permet l’aide à la décision. Gèrent l’ensemble des flux logistiques de la prévision des ventes au transport et calculent pour chaque opération, la m e i l l e u re solution, à partir de SGDB (interne ou PGI). B 2 B (vente entre entreprises) B 2 C (vente à des particuliers) Co-manufacturing : reconditionnement à la demande, assemblage de plusieurs références sur le lieu de stockage afin de constituer les commandes c l i e n t s . Co-packing : re g rouper des produits par lots pour des opérations de pro m o t i o n . Cross-docking : transformer l’entrepôt de g ro u p a g e / d é g roupage (sans stockage) en centre de p rofit, rajouter de la valeur à des tâches primaires. CPFR Collaborative Planning Forecasting & Replenishment : stratégie commune aux distributeurs et industriels visant à partager les précisions de ventes, de commandes, les plannings de production et de distribution. CRM/GRC Customer Relationship Management ou Gestion de la Relation Client : a m é l i o rer l’action des forces de vente et de marketing en mettant en face d’un client, dont on a mesuré la re n t a b i l i t é , le canal adéquat (Web, centre d’appels, commerciaux). D i fférenciation retardée ou postponment : méthode de production qui vise à garder le pro d u i t dans un état banalisé jusqu’à ce qu’il soit personnalisé au moment de la livraison au consommateur. DRP Distribution Resource Planning : planification des re s s o u rces de distribution. ECR Efficient Consumer Response : e fficacité et réactivité au service du consommateur. Stratégie i n d u s t r i e / c o m m e rce tendant à bâtir un système réactif partant du consommateur final pour re m o n t e r jusqu’aux distributeurs et fournisseurs qui travaillent ensemble, gèrent en commun les appro v i s i o n n ements, les promotions et les nouveaux produits pour apporter satisfaction au consommateur. EDI Echange de données informatisé. E-procurement : achats et appro v i s i o n n e m e n t transitent par Internet. ERP : p rogiciel qui organise et fait communiquer les flux d’informations à l’intérieur de l’entreprise, afin de créer une base de données unique, couvrant la gestion comptable, commerciale et gestion de p ro d u c t i o n . EVP Equivalent 20 pieds ( 6 m 0 6 ) : unité de mesure ISO dans la conteneurisation. Un conteneur de quarante pieds est comptabilisé dans la chaîne maritime pour 2 vingt pieds ou 2 EVP. Global Fulfillment : concept logistique considéran l’ensemble de la chaîne de valeur de la conceptio du produit jusqu’à la livraison au client final e intégrant le SCM (pilotage des flux), le SRM (gestio de la relation fournisseur) et le CRM (gestion d la relation client). G PA Gestion Partagée des Approvisionnements le fournisseur supporte la responsabilité de gestio du niveau des stocks chez le distributeur. G PAO Gestion de Production Assistée pa O r d i n a t e u r. H u b ("moyeu") : plate-forme logistique au centre d flux logistiques. J AT Juste à temps ou (JIT) Just in time déclencher l'ensemble des opérations industrielle sur la base des commandes fermes et non pas su prévisions comme avec la méthode MRP2. Kanban : composant de la production en Juste Temps (JAT). Etiquette associée à un conteneur d pièces sur laquelle figure la référence du produit e la quantité. Détachée du conteneur plein, l’étiquett remonte vers le poste amont et équivaut à un ord r de fabrication ou d’achat et à un ord re de transfert LLP Lead Logistics Providers : intégrateur d p remier rang, exerce le leadership sur les flux d leurs clients, fédèrent tous les modes de transport e x e rcent certains métiers, en sous-traitent d’autre s ( e n t re 3PL et 4PL). MRP Material Requirements Planning : m é t h o d e informatisée proposée par Orlicky (USA 1967) o PBC Planification des Besoins en Composants (pou g é rer les flux matière s ) . NTIC Nouvelles Technologies d’Information e de Communication. PGI Progiciel de Gestion Intégrée (voir ERP). PLM Product Lifecycle Management : gestion d p roduit durant toute sa vie, de la conception a retrait pour re c y c l a g e . SCE Supply Chain Execution ou progiciels d gestion d’entrepôts et d’emplacements p rogiciels de gestion et d’optimisation d’entre p o s a g e permettant de superviser les flux physiques e d’information au sein d’un ou plusieurs entrepôts c o m p rend des fonctions de définition d’espaces, d réception, de préparation et d’expédition. Les SC sont, au départ du moins, distincts des logiciels d gestion des stocks qui calculent les niveaux d stocks en fonction de règles de gestion pré-établie SCM Supply Chain Management : l o g i c i e l s permettant de piloter les flux de produits e d’information allant des fournisseurs de fournisseurs au client des clients, selon 4 grand p rocessus : planification, appro v i s i o n n e m e n t fabrication, livraison. SGDB Système de Gestion des Bases d D o n n é e s . SLI Soutien Logistique Intégré : ensemble de moyens humains, matériels, logiciels à mettre e œ u v re, envisagés dès la conception, afin d’assurer l service prévu, durant toute sa vie, par u équipement donné. SRM Supply Relationship Management : g e s t i o n de la relation fournisseur (GRF). TEU Twenty feet Equivalent Unit (voir EVP). G l o s s a i r eM i n i s t è re de l’Economie, des Finances et de l’Industrie D i rection Générale de l’Industrie, des Technologies de l’Information et des Postes Le Bervil – 12, rue Villiot – DiGITIP 5 - 75572 PARIS Cedex 12 - France Tél : 33 (0) 1 53 44 92 11 - Fax : 33 (0) 1 53 44 91 35 Site internet : www. i n d u s t r i e . g o u v. f r / F r a n c e t e c h e-mail : Francetech@industrie.gouv. f r AFII - Agence Française pour les Investissements Internationaux 2, avenue Velasquez - 75008 PARIS - France Tél : 33 (0) 1 40 74 74 40 - Fax : 33 (0) 1 40 74 74 01 Site internet : www. i n v e s t i n f r a n c e . o rg UBIFRANCE - Agence française pour le développement international des entre p r i s e s 14, avenue d’Eylau - 75116 PARIS - France Tél : 33 (0) 1 44 34 50 00 - Fax : 33 (0) 1 44 34 50 01 Site internet : www. u b i f r a n c e . c o m D i G I T I P |